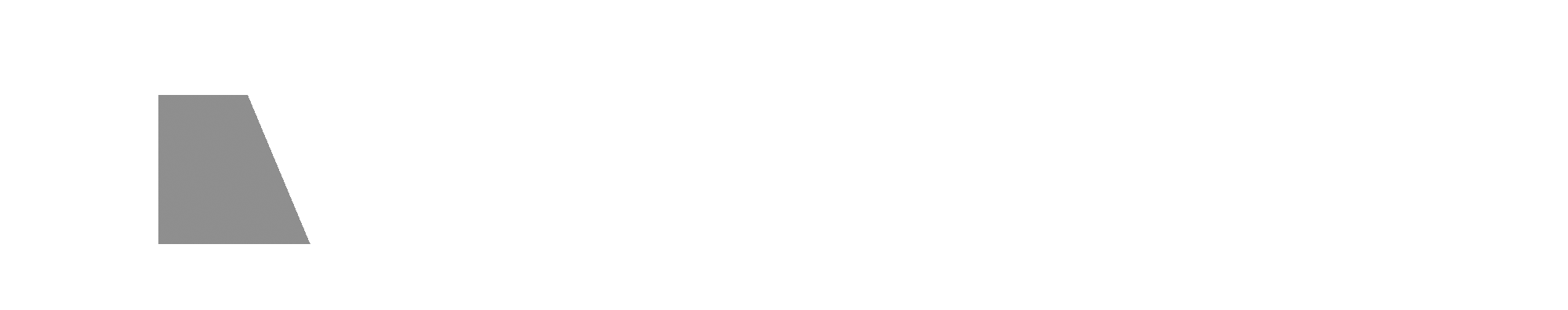Quel est votre parcours ?
Ma première envie de cinéma m’est apparue grâce à mon grand frère qui m’a initié aux arts en général. Il était curieux de tout et je l’ai naturellement suivi dans ses découvertes musicales, littéraires, picturales et cinématographiques.
Mon premier souvenir d’un film à la télé est Pour une poignée de dollars (1966) de Sergio Leone, et l’incroyable musique d’Ennio Morricone. Également, un soir, tard dans la nuit, je suis tombé sur Taxi Driver (1976) sans savoir ce que je regardais ; ce fut une révélation. Plus tard, Paris Texas (1984) et Tokyo-Ga (1985) de Wim Wenders, que j’avais en VHS, ont joué un rôle décisif pour moi et ma perception de ce que le cinéma pouvait transmettre.
Mais c’est la musique qui était au centre de mes passions. Après le lycée, toujours sur les traces de mon grand frère, j’ai donc fait une école de son, l’ISTS (section son de l’ESRA), pour devenir ingénieur du son musique. Mais la crise musicale du début des années 2000 (avec notamment l’arrivée de Napster) m’a fait bifurquer vers une spécialisation cinéma en troisième année.
À la suite de l’obtention de mon diplôme, j’ai d’abord fait beaucoup de courts métrages en tant que preneur de son, puis comme monteur son, après avoir peu à peu acquis du matériel de montage. C’est pendant cette période que je me suis construit un réseau avec des sociétés de production, mais aussi des technicien·nes de la Fémis et de Louis Lumière car à cette époque, mon école n’était pas très reconnue et peu de mes camarades étaient dans le milieu du cinéma. Dans un milieu où 90% des techniciens sortaient de la Fémis ou de Louis Lumière, je faisais office d’outsider. C’est pourquoi j’ai mis plus de temps que les autres à accéder au long métrage. Ma génération était aussi celle où l’assistanat commençait à disparaitre avec le numérique, où la post-production s’en trouvait simplifiée ou les budgets amoindris.
Le seul stage que j’ai fait était sur le film Avec tout mon amour (2001) d’Amalia Escriva, un tournage en Tunisie qui a été ma première expérience d’un plateau de long métrage. Je me rappelle encore de Jeanne Balibar avec qui j’échangeais au sujet de découvertes musicales ou littéraires très inspirantes. Elle me racontait aussi ses tournages avec Desplechin.
Ma première expérience de long métrage comme monteur son a été sur La Peau Trouée (2004) de Julien Samani, un documentaire sans aucune parole qui pendant trois jours montre la vie et le travail de pêcheurs bretons. Un film brutal et mystique.
Y a-t-il une expérience qui vous a particulièrement marqué ?
La Nuée (2020) de Just Philippot a été une expérience décisive pour moi. C’était la première fois que j’abordais un territoire sonore encore inexploré dans le cinéma de genre : les insectes. La fabrication, mais aussi la collaboration avec Just Philippot et Pierre Deschamps (le monteur image), ont été géniales. Le son avait une place décisive dans la réussite du film. Au début, nous avions conscience de fabriquer un objet inédit sans vraiment savoir ce que cela donnerait. Pour ma part, ce n’est qu’à la fin et après beaucoup de recherche et de tâtonnement que je me suis dit que l’on tenait un bon film de genre comme il y en a peu. Ce film m’a fait beaucoup progresser, mon regard sur la grammaire sonore s’y est beaucoup affinée.
Quelles sont les réalités de votre métier ?
Je crois qu’il faut être passionné pour faire ce métier. Dans mon cas, il a l’avantage de la diversité, aussi bien dans les projets que dans les lieux ou les équipes. À chaque fois, c’est une aventure faite de rencontres avec des gens et un univers. Il n’y a pas vraiment de routine, pour ma part en tout cas.
Les conditions matérielles sont d’ailleurs très variables selon les sociétés de production et chaque film a son “style” en matière de production. Cela peut aller du plus artisanal ou plus militaire dans la fabrication, la communication et l’organisation.
Ce métier peut être stressant au vue de la forte concurrence qui y règne. Ça n’est pas un métier comme les autres, les règles sont différentes que dans une société et on ne travaille pas forcément tout le temps. Il nécessite un investissement important dans le relationnel. Il ne suffit pas d’être bon. Ce métier nécessite certes des prédispositions pour la technique et l’artistique, mais aussi pour les rapports humains.
À quoi ressemble concrètement votre quotidien professionnel ?
Pour les phases de construction, généralement on commence par le travail sur les directs puis sur les ambiances, les effets et la musique. Puis arrivent aussi les post-synchro et les bruitages. Le tout est harmonisé au mixage, la dernière étape.
Mes journées se calquent sur des horaires de bureau mais peuvent s’étendre jusque tard dans la nuit si une urgence le nécessite. On ne compte pas ses heures. La période pré-Festival de Cannes est par exemple extrêmement chargée, la plus intense de l’année.
Je suis souvent seul et mes échanges se font principalement par téléphone. En équipe, on fait un point le matin et on mange ensemble. Le/la réalisateur·rice passe régulièrement, les producteur·rices vers la fin.